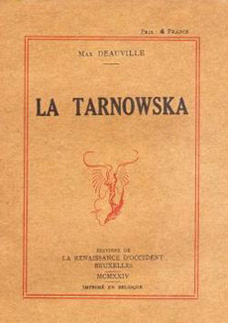Extraits d'oeuvres

« Contes Persans - Le Parfum des Roses (1928) »
Celle-ci a rassemblé les couleurs de tous les crépuscules.
Haroudj dans ses mains la tient offerte et il s’en exhale un parfum chaud comme celui de l’amour.
Entre ses chairs tendues, oranges et rouges se devinent le soufre et l’or.
Elle est belle comme l’heure qui passe, qui change et qui luit.
Des pétales sont tombés et leurs courbes ont la profondeur et le charme des bonheurs que l’on ne goûte qu’un instant.
Ainsi la vie s’en va.
Et demain tu les prendras ces pétales, et tu les serreras dans tes mains tremblantes avec des larmes dans le coeur car ils auront déjà le parfum du passé.
« Contes Persans - Le Pauvre Riche (1928) »
A tout moment le chien s’arrêtait pour se gratter.
Alors il entra dans une grande colère.
- Celui-ci a la gale, cria-t-il. Il sera dit que même ce chien me sera une charge
D’un coup de gourdin il le tua.
Les pieds dans le sable fin il se dirigea vers le désert où il n’y a plus d’arbres, plus de maisons, plus personnes.
Mais il avait beau aller plus loin vers la solitude, la paix ne pouvait entrer dans son coeur . Son âme était de plus en plus chagrine car c’était en elle que s’était logé le mauvais esprit, et non dans les choses qui toutes ont leur bon et leur mauvais côté.
Aussi n’étant plus entouré d’affections imparfaites et consolatrices, n’ayant plus même un chien pour pouvoir le gronder et le battre, Mesrour débarrassé de tout, se déchargea de la seule chose qui lui restait
encore et dont il n’avait plus que faire, c’est-à-dire de sa vie. Il défit son turban et, au dernier arbre de la route, il se pendit.
Que ceux qui ne sont point contents de leur sort méditent cette histoire.
« Contes Persans - Miranoé (1928) »
Ah ! qu’il est beau d’avoir un guépard ocellé.
Sur la terrasse de marbre blanc il dort, ou fait semblant, ouvrant de temps en temps ses yeux d’or, jaunes comme le soleil.
Sous son palanquin de pourpre sa maîtresse nue, Miranoé, est couchée sur le ventre, le menton dans les mains.
Elle regarde à l’horizon la cime verte des palmiers.
Deux esclaves noirs immobiles se découpent sur le ciel bleu. L’un tient un sabre, l’autre un éventail fait de plumes de paon. Rien ne bouge dans l’immensité.
La ville est silencieuse et lointaine.
Le guépard regarde sa maîtresse et passe sa langue rouge sur son mufle noir.
Miranoé s’ennuie et fait la moue.
Elle dit :
- Il ne se passe rien !
Le guépard lui, sait qu’on a grand tort de se plaindre, car lorsque dans la vie il arrive quelque chose c’est d’ordinaire un ennui.
Aussi sa longue queue est-elle agitée par un frémissement d’impatience.
Miranoé continue à se lamenter.
Elle baîlle.
Alors le guépard bondit et la mord à pleines dents dans le gras des cuisses.
Ainsi, ce jour-là du moins, il se passa quelque chose.
« Contes Persans - Solimania (1928) »
Solimania, tout autour de nous fait silence. Ecoute. Bientôt il fera nuit. Le chemin où pousse une herbe drue est bordé de sombres taillis. Au-dessus de leurs tours d’émeraude s’étend un ciel d’un bleu si pur qu’on le devine infini . Ecoute, voici que les notes d’un chant s’élèvent. Tu as froid, et tu t’appuies contre moi. Sur mon épaule ta tête se penche. Aujourd’hui le soir est merveilleux. Il pénètre dans mon coeur, et jamais comme aujourd’hui je n’ai entendu le chant de la nuit. Il est des heures, quelques-unes seulement, qui sont tellement émouvantes qu’elles marquent dans notre esprit une ineffaçable empreinte. Ce n’est que de quelques heures qu’est faite toute notre vie.
-----
Solimania, je te connais à peine. Nous nous sommes rencontrés trois fois, et de même que chez un enfant on ne reconnaît que plus tard les véritables traits, nous avons méconnu tout d’abord le sentiment qui nous poussait l’un vers l’autre. Tu es habituée aux amours passagères, et la vie ne m’a pas accoutumé à beaucoup attendre des lendemains, et pourtant, j’ai pour toi une reconnaissance infinie comme pour les fleurs qui s’ouvrent au printemps.
Dis-moi les choses qui bourdonnent dans ton coeur, dis-moi les désirs qui te viennent. Sur tes lèvres énigmatiques qui sourient, mets quelques paroles que je conserverai comme un souvenir de toi. Solimania, dis-moi, que désires-tu le plus au monde?
« Contes Persans - Sur un air de Shamishen (1928) »
A la vérité, ils n’étaient ni rouges ni noirs, comme ils l’affirmaient avec violence, mais c’était beaucoup plus sérieux que s'ils l’eussent été matériellement.
Si on les avait trouvés réunis, un parti dans le Nord, le second dans le Sud, tout eût été facile, on se fût battu sur-le-champ et l’affaire se serait réglée par la victoire de l’un ou de l’autre. Mais ils étaient également répartis de tous les côtés. En outre l’affaire se compliquait de ce qu’au-delà des frontières il y avait des pays qui se disaient Pings eux aussi, et d’autres Mings. Aussi soutenaient-ils tels ou tels suivant le cas, quoiqu’ils fussent aussi mélangés que la Chine, de Mings et de Pings dans leurs propres frontières.
-----
Qu’était-ce au juste qu’être un Ping? Il était bien aisé pour un Ping d’y répondre. C’était de ne pas être un Ming. Et l’essence d’un Ming pour un Ming était de ne pas être un Ping. Pour un Ping un Ming constituait un danger pour l’Etat. Pour un Ming un Ping était la même chose. L’Etat ne s’en trouvait pas mieux.
-----
Les chefs des deux partis, leurs tenants et leurs exégètes ne cherchaient pas non plus à trop approfondir la question, de peur qu’à l’étude on vît les deux doctrines se confondre. Ils préféraient dans les harangues se servir de grands mots et d’images farouches qui portent bien plus à s’exalter qu’à réfléchir, plutôt que de se livrer à des investigations déprimantes. – Le doute en politique est la pire des choses.- C’est pour cela que les ignorants y réussissent mieux que les savants notoires.- Et si dans leur esprit survenait quelque critique, ils s’empressaient de hurler davantage, pour ne pas enrayer le dynamisme de leurs adorateurs. Avoir raison n’est rien. Le croire seul conduit à la victoire.
« Dernières Fumées (1937) »
L’armée n’est point un milieu où puisse vivre un esprit inquiet. L’esprit le plus inquiet s’y trouve bien vite tranquillisé. Un ordre ne doit pas être compris. Il doit être exécuté. Un officier ne dirige pas un service, il se conforme à des circulaires. Dans ces conditions, qu’est-ce qui pourrait faire naître l’inquiétude ? Au bout de peu de temps l’homme le plus agité se calme, le plus ergoteur se tait, tous deux signent et transmettent pour exécution. Ainsi leur responsabilité se trouve à couvert, la sérénité ne quitte plus leur ciel. Dès ce moment ils ont atteint le port de salut. En effet, le but d’une armée n’est point de gagner des victoires, mais d’observer les règlements militaires. Celui qui remporte un succès sans se conformer aux usages n’est pas à l’abri des critiques. Celui qui subit un échec d’après les règles établies est au-dessus de tout reproche.
-----
Les hommes supportent beaucoup de celui qui est un vrai chef, de celui qui les commande et les dirige réellement dans les moments où ils sentent que la mort les guette de tous côtés. Mais ils haïssent rapidement celui qui tremble en première ligne et devient rogue quand le danger est écarté. Ils considèrent comme une offense personnelle, de voir distribuer des distinctions aux peureux et aux incapables à l’occasion de leurs propres sacrifices.
-----
L’important, dans un ordre, n’est pas tant ce qu’il contient, mais bien les ennuis qui peuvent en résulter pour vous.
Chaque fois que vous recevez un ordre, prenez votre temps, examinez-le bien. La solution la plus élégante que vous puissiez trouver est de le transmettre. Ainsi votre supérieur conserve la responsabilité de ce qu’il a écrit ; vos inférieurs, d’autre part, se découvrent en l’exécutant. Vous seul êtes invulnérable.

« La boue des Flandres (1922) »
La guerre nous a-t-elle apporté quelque apparition nouvelle de la beauté ? Non. Si parfois un spectacle a pu nous émouvoir, la guerre n’y était pour rien. C’était que la nature s’illuminait pour nous malgré tout, offrant à nos regards avides d’inconnus ses horizons tentaculaires, l’or et le sang de ses crépuscules. Si elle nous a parfois fait mieux voir dans le coeur des hommes nous n’y avons rien trouvé de beau. Ne broyons pas du noir. Le monde n’est que pourriture, lâcheté et injustice. Mais à quoi bon en parler.
-----
Mais demain viendront des gens qui parleront de courage, de héros, de gloire. C’est dans la suite naturelle des choses. Quand un misérable soldat abruti par la peur, ou luttant de toute son énergie pour y résister aura été déchiré par un brusque éclatement, qu’en restera-t-il ? Un tas de chairs, d’entrailles et de loques souillées de sang, auxquels les injures de la poudre auront donné l’aspect des détritus que déversent les poubelles. La grimace du mort sera presque toujours grotesque dans son horreur, et il en sera de même des gestes déjetés de ses membres brisés. Pourtant lorsqu’il aura été couché sur un brancard et que sous sa couverture étendue, la forme allongée de son corps se reconnaîtra, il commencera à reprendre une existence nouvelle. Il n’était plus rien. Voici que de nouveau il est quelque chose. Il s’en va au pas cadencé des porteurs. Ceux-ci en titubant dans le dédale de terre remuée, l’emportent vers une réincarnation. Corps morcelé il sera déposé dans une caisse en bois blanc. Et lorsque les couleurs du drapeau, en larges touches rouges, jaunes, noires l’auront recouvert de leurs teintes violentes que le soleil exalte, alors il deviendra un brave, un vaillant, que les vivants salueront de leurs gestes et de leurs sonneries, un héros qui entrera de plein pied dans le mensonge de l’histoire.
-----
Nous parlons du froid, de la faim, de la misère, mais nous ne trouvons pas de mots pour décrire le rictus du néant. Il nous poursuivait le long des routes interminables. Le Christ a dû le voir aussi lorsque, le front pesant sous son casque d’épines, la figure ruisselante de sang, il ployait sous le fardeau trop lourd de nos peines.
-----
La guerre nous a appris à comprendre la misère de ceux qui toute une vie travaillent sans espoir, pour les autres. Car le fruit de tout ce que nous avons fait nous le voyons sur la poitrine des voleurs. Ils nous ont pris notre liberté, notre amour de la vie, notre joie, ils nous volent aussi notre gloire….
-----
Nous étions écrasés sous tout le poids du monde comme les morts sous la chape de limon qui les couvre. C’était la nuit. Personne n’a vu dans nos âmes alors. Le coeur lourd et les doigts gourds nous avons ramené nos couvertures de bure sur nos têtes. Nous avons eu le tort de ne pas mourir….
-----
Hélas dans la vie nul n’est ce qu’il croit être, et nul n’est exactement l’homme que les autres dépeignent ! Par ces réflexions désabusées nous arrivons à comprendre.
-----
Que la vérité découragée se soit réfugiée dans un puits. Et c’est encore une de nos illusions de croire qu’elle est belle parce qu’elle est nue.
-----
La mort crie, elle glapit, elle approche. Ce n’est plus la mort de jadis, solennelle, qui se penchait sur un lit, ni celle qui fauchait au grand soleil ceux qui marchaient le front levé vers la lumière. C’est la mort lâche qui assassine dans un trou, dans la terre, dans la boue, dans la tombe ouverte déjà. Nous sommes aux confins du monde, au bord de l’abîme. Nos mains n’ont plus une herbe, un rameau pour se raccrocher. Nous sommes des morts que l’on tue au cimetière.
-----
La guerre n’est que le suicide misérable d’une foule en folie. Ses remous sanglants ne servent que les intérêts de ceux qui la dirigent. Et même s’il faut qu’un jour pour sauver un pays ou l’honneur, de nouveaux soldats prennent les armes, pourquoi leur mentir, pourquoi faire miroiter devant leurs yeux le mirage de la gloire et de l’héroïsme ? S’ils savent à quel point la guerre est basse et laide, s’ils savent qu’ils n’en retireront que la mort ou la déchéance de leur âme, s’ils se résignent quand même, s’ils marchent au danger sans illusions et sans espoirs, leur sacrifice en sera-t-il moins grand et moins méritoire ?
Hélas ! Nous ne sommes rien.

« Le Métier d’Homme (1914) »
Timide et distrait, élevé par des parents qui ne pouvaient s’entendre, forcé d’obéir pour les plus petites choses à des ordres absolument contradictoires, il s’était habitué à toujours attendre le dernier moment pour prendre une détermination. Il était semblable à ceux qui espèrent que les événements les forceront à agir, et leur fourniront une excuse auprès des spectateurs hostiles de leur existence.
Bousculé, poussé de-ci, tiré de-là, on le trouvait toujours prêt à suivre l’avis dont l’exécution amènerait le moins de scènes. Ce qui n’était pas la bonne politique, car en prenant tour à tour parti pour l’un ou pour l’autre, il finissait par rassembler sur sa tête les reproches de chacun.
Il est bon, dit-il, de ne pas avoir de respect pour les vieillards. Leurs raisons sont des raisons de vieillards. Et si avec le temps nous les trouvons justes, ce n’est point qu’elles soient bonnes en elles-mêmes, mais bien que nous-mêmes nous vieillissons. Tu ne peux comprendre tout ce que Gugenheim t’a dit, parce que ce qu’il t’a dit n’était bon que pour Gugenheim. Admire pourtant qu’il ne t’ait point parlé de l’avenir, en cela il fut un maître. La vérité c’est que nous sommes des dupes, toujours des dupes. Nous allons sur la route et nous nous réjouissons de marcher à l’aise. Voici que le temps vient et qu’il nous coupe un pied, qu’il nous arrache un œil, des cheveux, des dents. Et nous, que faisons-nous ? Nous nous faisons mettre un pied artificiel et nous nous réjouissons de pouvoir avancer quand même vers l’avenir. L’avenir consiste à perdre l’autre pied, un bras, l’autre œil, notre cœur.

« Prières d’un incroyant (1923) »
Lorsque mes yeux s’obscurciront à la lumière et que les objets autour de moi ne n’apparaîtront plus qu’au travers d’un voile.
Lorsqu’à mes oreilles n’arrivera plus qu’un vague bruit de paroles. Lorsque mes oreilles n’entendront plus que le bruit douloureux de mon sang.
Lorsque mon front se couvrira d’une sueur froide, lorsque mes cheveux trempés et collés sur ma peau ne donneront plus aux miens qu’une sensation d’horreur.
Lorsque ma bouche entr’ouverte ne laissera plus passer qu’un souffle rauque et entrecoupé.
Lorsque ma langue sèche se refusera à la parole.
Lorsque mon esprit s’hypnotisera sur la sensation lointaine d’une douleur.
Lorsque mes membres inertes se refuseront à se mouvoir.
Lorsque ma tête pèsera le poids d’une pierre.
Lorsque tout mon corps sera perdu déjà pour la terre.
Lorsque mes yeux ne verront plus que des visages estompés comme dans un rêve ou un souvenir.
Lorsque mes yeux sans vie rouleront dans les orbites et seront pour les miens un sujet d’effroi.
Lorsque mes doigts animés d’un mouvement continu se crisperont sur le suaire.
Lorsque je ne serai plus capable de sentir la pression des mains qui me sont chères.
Lorsque ceux que j’aime pencheront vers moi leur face angoissée, interrogeant les derniers signes de mon âme presque éteinte.
Lorsqu’il me faudra tout le reste de mon énergie pour ranimer par instants une lueur dans mes yeux, lueur sans force et presqu’aussitôt éteinte.
Lorsque mon coeur sera mort pour ceux qui m’ont aimé, pour ceux dont je fus le compagnon et l’ami, qui ont souffert par moi et pour qui j’ai souffert. Quand mon corps ne sera plus que l’image du dégoût et de la terreur. Dans la nuit prête à s’appesantir sur moi, au bord du silence et du désert, à l’aube du néant et de l’inconscience, sache ô mon âme conserver le courage de ne rien craindre et de ne rien désirer.
Que cette pensée soit pour toi l’héritage de toute une vie. Qu’elle flotte dans ton esprit obnubilé, comme les phrases depuis longtemps apprises et souvent répétées des prières.
Tu es sortie du silence, voici que le silence te reprend. Tu es venue du désert et de l’inconscience, tu retournes au désert et à l’inconscience. Que le cours des choses se fasse. Il est injuste et impie de se raccrocher à quelque espérance, car tout n’est que vanité, même la crainte de la mort.

« Rien qu’un Homme (1926) »
D’abord, qu’est-ce qu’un homme ? Un homme ? Un homme ! On dirait qu’il existe pour vous un être supérieur, aux instincts purs et merveilleux, auréolé de toutes sortes d’altruisme et de générosité, un homme grand, noble et illuminé. Un homme, cela n’existe pas. Il y a des hommes. Un troupeau. Et chacun est une misérable mécanique, avec des idées transitoires et sans réel fondement. Il n’y a pas d’homme, il y a des habitudes, l’un est gendarme, l’autre est géôlier, l’autre est Président du tribunal, et tout cela forme le troupeau. Tous les hommes sont laids, vilains et pleins de défauts, mais il faut les empêcher de ruer dans le troupeau. Vous comprenez ? Et l’Homme, dont vous parlez toujours, en croyant tous que c’est Vous cet homme idéal, cet homme n’existe pas. Celui-ci a rué dans les rangs, il faut qu’il soit pendu pour lui apprendre, et surtout pour apprendre aux autres à se tenir tranquille.
« Tamerlan (1938) »
Tu es venue vers moi des confins du monde. Que béni soit le jour de notre rencontre ! Et l’amour a fleuri…Il y avait dans mon âme une image de la beauté et je ne parvenais pas à la saisir. Et voici que devant moi elle s’est dressée, parfaite, dans ta beauté. Et elles se confondent. Tais-toi. Ne brisons pas le charme. Tous les deux nous avons traversé un désert immense, marchant l’un vers l’autre, poussés par une force invisible. Et quand nos mains se sont tendues l’une vers l’autre, quand nos regards se sont rencontrés, nos bouches sont restées muettes et le désert autour de nous s’est rempli de fleurs merveilleuses, de floraison, de verdure, d’oiseaux et de sources claires. Tais-toi, ne brisons pas le charme, il n’est au monde une parole qui vaille la profondeur de ton regard, rien qui égale ta présence. Aïsha, ton nom est à mes lèvres doux comme le miel ! Mon coeur se gonfle quand je le prononce. Aïsha ! Les étoiles sont au-dessus de nous pour notre seul amour, l’horizon qui nous encercle forme en cette heure la limite du monde. Rien n’existe au-delà, pas plus dans le passé que dans l’avenir. Aïsha que m’importe l’empire et le monde, vaines images auxquelles s’attachent notre ennui, notre vanité et notre inquiétude. Ils sont moins grands que notre bonheur. Car notre bonheur peut se passer de toute vanité et ne subit nulle emprise. Il est l’éclosion de nous-mêmes, et son épanouissement est la seule chose qui puisse arrêter la course de l’heure, pour un temps qui nous semble infini.
-----
Dieu Tout-Puissant. Nous aussi nous sommes des dieux à certaines heures, mais le rôle est trop lourd pour nos épaules sans doute, ou bien tu te plais à nous faire retomber sur la terre. Maudit sois-tu ! Dieu Tout-Puissant, nous sommes face à face. J’aime ma poitrine sur laquelle coule la nuit, mes bras qui se tendent vers toi, mon front que ta lumière inonde. Tout mon corps, où la vie coule harmonieusement malgré les années, s’élève vers toi. Je t’aime, mais je te hais aussi parce que tu es l’avenir, parce que tu es l’inconnu, la mort qui ferme les yeux. Où te caches-tu, toi qui es tout et qui n’es rien encore ? Dieu Tout-Puissant, je suis en ce moment tout ce qui existe sur la terre. Tout ce qui est autour de moi vit par moi, et je me suis installé en roi dans ton royaume. Comme toi je suis seul et je goûte à ton image, avec volupté, la profondeur du silence et de la solitude absolue.
-----
Comme toi j’ai semé sur la terre la mort, la guerre, la famine, le feu. Je suis un simulacre de ton idole. Je ris de ceux qui m’aiment et qui me servent. Ils sont pour moi comme des ennemis, sur le même plan que ceux qui me haïssent. J’attends leur heure comme tu attends la mienne, dans l’indifférence ineffable. Regarde. J’ai les mains ouvertes, et j’ai laissé couler entre mes doigts, comme y coulent maintenant les scintillements de la nuit, tous les plaisirs, toutes les joies, tous les bonheurs, toutes les souffrances de ce monde. Elles se sont accumulées sur la tête et les épaules de ceux qui grouillent en-dessous de nous et dont les rumeurs persistantes viennent jusqu’ici comme une lointaine musique. Je les ai laissé couler pour être seul devant toi, au-dessus de tout, et je ne vois dans le ciel que le clignotement des étoiles, le croissant mort de la lune, et je n’entends que ton silence. Ton silence est terrible ! Mon bonheur est si grand qu’il se confond avec la désespérance infinie. Je te hais, parce que tu es plus grand que moi, et pourtant je t’aime, comme si tu étais moi-même.